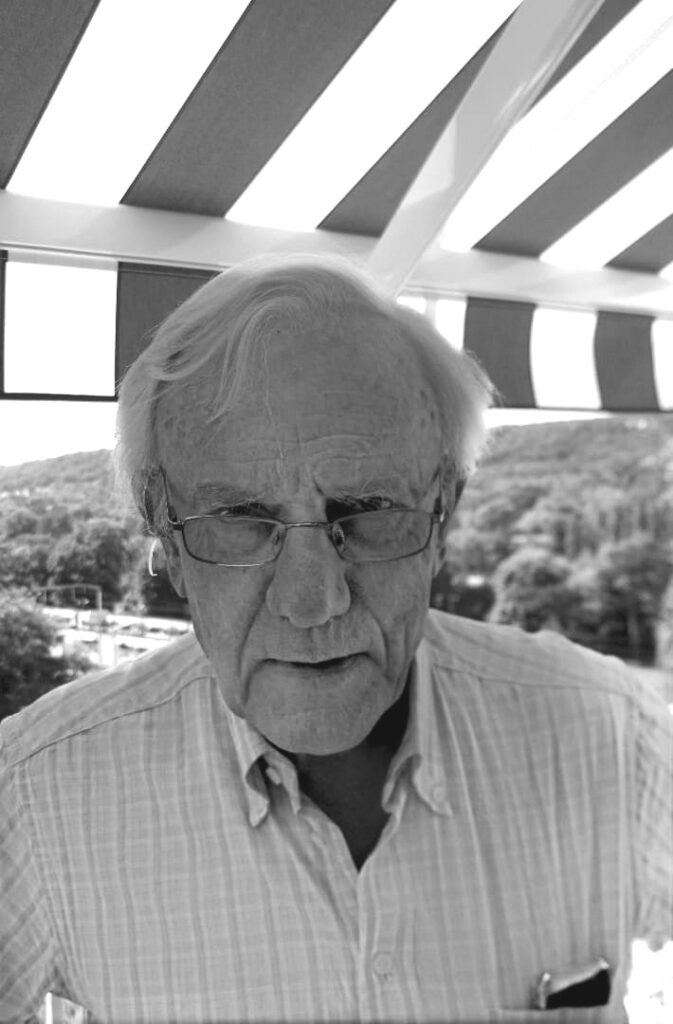
Avec le Grand Paris Express, le coût pharamineux du vide [N°18]
[Entretien publiée dans Le Chiffon n°18 de l’automne 2025]
Le Grand Paris Express, extension du métro parisien, est l’un des plus vastes projets d’infrastructure du vieux continent. Pour faire passer la pilule, la Société du Grand Paris tente de le vendre comme l’incarnation de la « transition écologique » de la mobilité. Nous avons rencontré Harm Smit, ingénieur et spécialiste de l’aménagement et des mobilités urbaines, coauteur en 2024 du livre L’imposture du Grand Paris Express, un éléphant blanc qui trompe énormément. Entretien.
Le Chiffon : Pourriez-vous résumer le projet du Grand Paris Express ? Qu’est-ce qui vous a poussé à vous y consacrer depuis plusieurs années ?
Harm Smit : Le Grand Paris Express (GPE) prend racine en 2003, lorsque le chef d’entreprise et député (UDF) des Yvelines Christian Blanc est chargé par le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin de réfléchir à un projet pour aménager le plateau de Saclay. Il publie un rapport, puis un livre, La croissance ou le chaos, qui séduit Nicolas Sarkozy, alors ministre des Finances. Élu président de la République en 2007, Sarkozy nomme Blanc secrétaire d’État « au développement de la région capitale ».
En 2009, un premier projet de loi prévoit le développement d’un immense « cluster » technologique et scientifique à Saclay. La loi sur le Grand Paris de 2010, y ajoute un réseau de métro. Alors, la commission nationale du débat public (CNDP) organise un débat autour de deux projets : celui de l’État, portée par Christian Blanc, et Arc Express du Conseil régional d’Île-de-France (« la Région »), dirigé par Jean-Paul Huchon (PS).
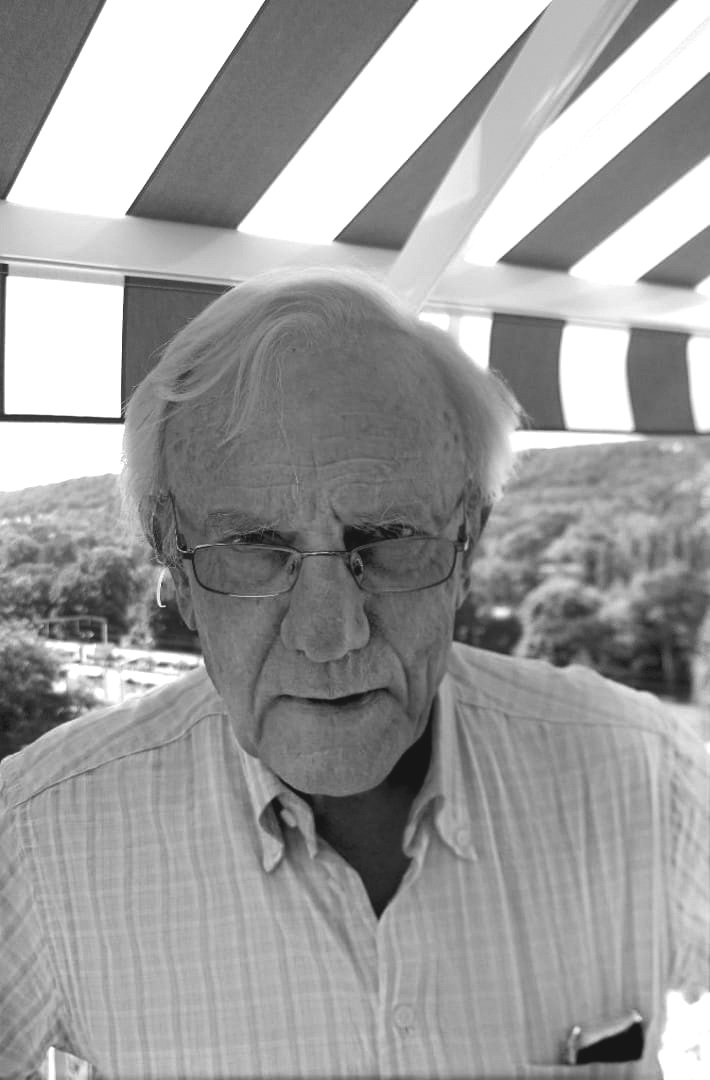
En janvier 2011, l’État et la Région s’accordent sur une synthèse des deux projets, nommée « Grand Paris Express ». En 2013, elle prend la forme de quatre nouvelles lignes de métro (15, 16, 17 et 18) et l’extension de deux existantes, la 11 et la 14.
Pour ma part, je navigue dans les milieux associatifs locaux et régionaux depuis 1980. En 2009, je deviens coordinateur du Collectif OIN Saclay (COLOS), qui vise à préserver un plateau de Saclay vivable. Je dois mes compétences en urbanisme à mes collaborations avec d’éminents experts.
La ligne 17 du Grand Paris Express, de Saint-Denis à l’aéroport de Roissy, était censée se justifier parce que desservant le mégacomplexe Europacity et le terminal 4 de Roissy, deux projets depuis abandonnés. Dès lors, comment expliquer que sa construction se poursuive ?
La Société du Grand Paris1(SGP) tient à ce projet comme à la prunelle de ses yeux. De leur côté, la Région, le conseil départemental du Val-d’Oise et la municipalité de Gonesse poussent pour bétonner toujours plus le Triangle de Gonesse. L’argent ne constitue pas un frein pour les décideurs : ils finissent toujours par en trouver, via taxes et emprunts.
Fin 2019, une mission est confiée au haut fonctionnaire Francis Rol-Tanguy pour envisager l’avenir du site. Il présente trois scénarios : tout bétonner, ne rien faire ou bétonner partiellement, qui sera l’option retenue. Quant à la remise en question de la déclaration d’utilité publique, aucune loi ne l’impose. Le gouvernement n’ayant pas jugé utile de lancer une enquête publique modificative, comme pour d’autres projets, la ligne 17 poursuit sa route presque automatiquement, aidée par des politiciens en quête de prestige pour leur territoire et pour eux-mêmes.
La SGP affirme s’inscrire dans une logique de « transition écologique de la mobilité2». Mais ne serait-il pas plus pertinent d’améliorer les transports existants, plutôt que de construire de nouvelles infrastructures énergivores ?
Pour les ingénieurs, construire du neuf est plus valorisant que de rénover ; pour les élus, ces projets offrent visibilité et gains électoraux. Si la SGP justifie ses projets par la promesse de réduire les déplacements en voiture (qui représentent 82 % des kilomètres parcourus en France ces quinze dernières années3), c’est un vœu pieux : la modélisation de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) d’Île-de-France prévoit un report modal (de la voiture au métro) de 0,9 %4.
Pour qu’un transport collectif soit attractif, il faudrait un maillage très dense, ce qui n’est faisable que dans les zones urbaines. En zone périurbaine ou rurale, les gens n’ont pas d’alternative crédible à la voiture. La ligne 18 Ouest (Saclay-Versailles) n’atteindrait que 2 000 passagers par heure, en heure de pointe, loin des 6 000 nécessaires pour justifier un métro. Quant à la ligne 17 Nord (Le Bourget – Le Mesnil-Amelot), elle devait initialement doubler l’accès à l’aéroport de Roissy, mais ce rôle est désormais assuré par la ligne rapide (et très onéreuse) du CDG Express. Finalement, elle traverserait des zones peu habitées et ne répondrait pas aux besoins locaux. Nous sommes moins dans une « transition des mobilités » que dans un déferlement d’infrastructures coûteuses et néfastes.
Dans vos travaux, vous démontez la notion de « transports structurants » qui sous-tend toute la démarche de la SGP. Que dit-elle et en quoi vous semble-t-elle critiquable ?
Cette notion postule que l’aménagement urbain se base sur les infrastructures de transport : elles formeraient un squelette autour duquel il ne reste plus qu’à mettre de la chair pour composer une ville. C’est une vision très statique. Or, une nouvelle ligne de transport modifie l’organisation du territoire : les ménages s’installent plus loin pour obtenir des logements moins chers ou plus proches de la nature, tandis que les entreprises déménagent pour améliorer leur rentabilité. En effet, les gens maintiennent un « budget-temps de déplacement » stable, autour de 90 minutes par jour en Île-de-France. Résultat : c’est l’espace qui s’étire. « Trop de vitesse de déplacement fait perdre du temps à tout le monde » disait l’urbaniste Marc Wiel.
En réalité, la ville est surtout structurée par les prix du foncier et la localisation des bassins d’emplois et bassins d’habitat. Par ailleurs, on oublie très souvent d’analyser les caractéristiques de la main-d’œuvre, comme si tous les travailleurs étaient interchangeables. Ainsi, les pôles d’emplois desservis par la ligne 16, comme Le Bourget et Champigny-sur-Marne, ne correspondent guère aux qualifications des habitants de Clichy, Montfermeil et Sevran, dont les actifs travaillent surtout à Paris, d’où la faible utilité de la ligne 16.
La SGP prévoit d’urbaniser plus de 140 km² (1,3 fois la superficie de Paris) autour des 68 nouvelles gares, incarnant la grande opération immobilière francilienne de ce début de siècle. Pourtant, le nombre de logements vacants et la surproduction d’espaces de bureau atteint des sommets. Ainsi, peut-on dire que le GPE incarne une « transition écologique » ?
La SGP finance le GPE en émettant des « obligations vertes » sous prétexte que le GPE réduira les émissions de carbone liées aux déplacements en voiture et permettra de maîtriser l’étalement urbain. Mais ce ne serait vrai que si les usagers vivaient et travaillaient autour des gares, auquel cas ils n’auraient pas besoin du GPE… En effet, une gare facilite l’accès à des emplois situés loin du domicile. La doctrine de la SGP va donc à l’encontre de l’objectif affiché à cor et à cri de réduction des distances domicile-travail ; de même, elle vient contredire la logique de la « ville du quart d’heure », où tout devrait être accessible à proximité.
Et ce n’est pas tout. Des élus du Val-d’Oise exercent désormais une pression pour que soit implantée une ligne 19, de sorte à desservir leurs communes. Comment analysez-vous cette demande ? Quelle alternative mettez-vous en avant ?
Ces demandes de prolonger le GPE sont d’ordre politicien plus que fonctionnel. Pourtant, la mobilité doit être adaptée aux réalités locales : dans bien des cas, bus ou tramways sont plus pertinents. Multiplier les métros « rapides », coûteux et surdimensionnés pour des zones peu denses, c’est ignorer les vrais besoins. Exemple : la ligne 18 relie trois bassins dont les déplacements internes sont 21 fois plus nombreux que ceux entre bassins.
Le projet de ligne 19 semble conçu pour mieux justifier la fuite en avant que constitue la gare au milieu des champs à Gonesse sur la ligne 17. Ce projet chimérique bloque des alternatives plus utiles comme le tram-train T11, qui desservirait davantage d’habitants pour un moindre coût. Tout cela entretient une illusion de « transition écologique » à travers un projet d’artificialisation dicté par des intérêts privés, séparé des réalités locales et largement déficitaire (cela pourrait atteindre 70 milliards d’euros). Nous avons là quelques raisons de nous y opposer.
Entretien et photo-portrait de Clara Demurtas
- Renommé Société des grands projets fin 2023.
- Une nouvelle stratégie pour consolider les bénéfices environnementaux du Grand Paris Express, Société du Grand Paris, octobre 2021.
- « Que nous disent les bilans annuels des transports ? », Jean-Pierre Orfeuil, Transports, Infrastructures & Mobilités, mai-juin 2025.
- Modélisations des déplacements en IDF […], mars 2021. À retrouver sur le site web de la DRIEAT.

